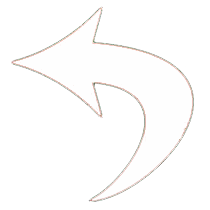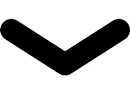
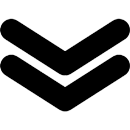
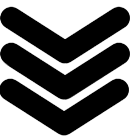
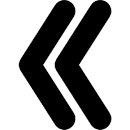
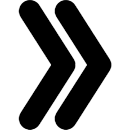
LE MONCEAU DʼOREn un village, en un hameau, Deux frères vivaient calmement. Jamais ils n’avaient de dispute, Aucun des deux n’était méchant. Un jour ils partirent ensemble Chasser perdrix et écureuil. Dans le fond, ils pensaient ceci : « Et si nous trouvions un renard ? » Les frères marchent à grands pas, Laissant leur maison loin derrière. Dans la fôret ils rencontrèrent Un homme âgé à barbe blanche. « Écoutez, n’allez pas plus loin, Leur dit le grand-père barbu. Par ce chemin, mes chers enfants, Vous ne trouverez rien du tout. » « Bien sûr que si. Qu’en sais-tu donc ? Lui répondit l’un des deux frères. Ce qu’on voit de cette forêt Ne nous paraît pas trop mauvais. » Le vieux grand-père à nos deux frères Redit : « Écoutez-moi. Ici, Point de perdrix ni d’écureuil, Renard et louveteau non plus. Je vous en prie, n’y allez pas. Un grand serpent gît près d’ici. Écoutez-moi, qui suis âgé. Et l’homme âgé n’est pas dément. Allez-y : il vous mangera, Ainsi que l’ours mange la vache. Rentrez chez vous, mes bons enfants, Tant que vous êtes encor vifs. » Le vieux s’en fut parmi les arbres. Longtemps les frères demeurèrent. Ensuite, après conversation, Le sang bouillonna dans leurs cœurs. « Allons-y, n’ayons peur de rien. Tiens, Vańö, allons çà et là ! » Ainsi parla à son grand frère Öńö, le plus jeune des deux. L’aîné brandit son arquebuse : « Voici ce qu’on a pour la bête ! Mon arquebuse et ta cognée Vont lui raccourcir l’existence ! » En avant les gars se ruèrent. Öńö porte sa hache au poing. L’autre se tient prêt à tirer. Nul des deux n’a la main qui tremble. Ils ne coururent pas longtemps. Une clairière entre les arbres Apparut, où de jolies fleurs Poussaient parmi une herbe drue. Alentour regardent les frères, Si le serpent montre sa tête, Et qu’il ne tombe tout d’abord Sous leur propre coup d’arquebuse. Mais le serpent n’apparaît pas. On entend bruire la clairière. Öńö vit un grand monticule Rouge et brillant comme le feu. « Qu’est-ce là qui nous éblouit ? Quelqu’un a allumé un feu ? S’exclama-t-il. Allons, Vańö, Approchons-nous de ce prodige. Au tas brillant comme le feu Les frères vinrent sur-le-champ. Et ils écartèrent les bras, S’émerveillant et s’écriant : « Des pièces d’or ! Un monceau d’or ! Richesse innombrable, infinie ! On n’en verra jamais autant, Même par-delà l’océan ! Avec cet or, il va pousser Des ailes sur nos deux épaules. Avec ces pièces, nous vivrons Comme vivent les négociants. Notre logis grand comme un temple, Nous y mangerons du pain blanc, Aurons des samovars d’argent, Tasses d’argent, cuillers d’argent. Nous devons aller au bazar : Cocher, la troïka est prête ? Ce sera la vie de château : Douce, agréable, et très joyeuse ! » Ainsi devisèrent les frères, Voilà quel était leur discours. La dimension du monceau d’or Était d’une brasse de tour. « Écoute un peu ce vieux grand-père, Reprit Vańö tout guilleret. Si nous n’étions venus ici, Nous serions longtemps restés pauvres. » « Toutes ces pièces, reprit l’autre, Rassasieront beaucoup de bouches. Et les enfants de nos enfants N’en verront pas encor le bout. » Mais ils méditent en secret : « Cette affaire est bien ennuyeuse, Que ces richesses que voilà À moi tout seul ne soient échues. » Longtemps ils furent immobiles. L’or leur éblouissait les yeux. Une pensée hantait leurs têtes : « La moitié du tas fera peu ! » Vańö dit à son petit frère : « L’or n’ira pas dans la besace. Tu ne peux tout porter sur toi, Sans cheval tu ne feras rien. Rentre, Öńö, chercher un cheval. Tes jeunes jambes vont plus vite : Ici je veillerai sur l’or, Jusqu’à ton retour au galop. » Öńö ne s’y opposa point : Ça ne lui prendrait pas longtemps. Il prit sa hache sous le bras, Au logis fila promptement. Öńö fut vite à la maison, Il ne revient pas de sa joie. « Baba, Baba, ce qu’on a vu ! Beaucoup de roubles en monnaie ! Dans le bois gît un monceau d’or, Richesse innombrable, infinie. On n’en verra jamais autant, Même par-delà l’océan ! Mon frère âiné veille sur l’or, Pendant que j’amène un cheval. Il veut emporter de là-bas La moitié de l’or, pour sa part. Allons, Baba, ne donnons pas La moitié de l’or à mon frère. De ce monceau qui est le nôtre Qu’il ne soustraie pas trois kopecks. Vite, vite, Baba, fais cuire Un poison mortel dans du pain, J’en ferai manger à mon frère Et puis tout ira pour le mieux. » La baba dit à son moujik : « J’y vais illico, n’aie pas peur. Le monceau d’or sera à nous, Partageons point avec ton frère. » Elle prit un poison mortel, En mit deux pincées dans du pain. Elle en fit cuire dix boulettes Et enduisit le tout de beurre. Öńö prit les petits pains ronds Et dit : « Tu as bien travaillé ! Si frérot meurt, le monceau d’or Je l’emporterai tout entier ! » Le cheval prêt et attelé, Il se précipita derrière. Il pousse Ryžko en criant : « Hue, hue, dépêche-toi, mon coeur !… » Pendant qu’il approchait, Vańö, Le frère aîné qui gardait l’or, Dans un élan de convoitise Pensait des pensées malicieuses : « Öńö arrive vite, vite, Tu ne peux t’en débarrasser. Il faut partager le tas d’or, Donner la moitié du monceau. Je ne ferai pas le partage, Ne donnerai pas trois kopecks ! Je l’abattrai à l’arquebuse, Et j’aurai le tout pour moi seul. » Vańö s’étend derrière l’or, Il sait ce qu’il lui reste à faire : Il mit l’arquebuse à l’épaule, Leva le chien, prêt à tirer. Son cœur était comme une pierre, Il ne chérissait plus son frère. Seul l’or était cher à ses yeux, Seul l’or lui causait du chagrin. Il était tapi depuis peu, Quand il entend trotter tout près. Il voit arriver en télègue Son petit frère à vive allure. Vańö ne frémit pas du bras, Car il était un bon tireur. Il tira sur son frère au front, Afin de lui fendre la tête. La balle trouva son chemin, La balle ne manqua sa cible. Öńö tomba, Öńö mourut. Il ne connut pas la richesse. Vańö se releva de terre, Et il avait les yeux hagards : « Je n’ai plus besoin de donner Au cadet la moitié du tas. À présent, à moi sera l’or, Le grenier plein, le pain d’épice. À présent, ma vie de château N’aura de terme ni de fin. Au rang de riche négociant À présent la voie m’est tracée. À présent, même le doyen Ne pourra pas m’incarcérer ! » Alors il vit sur le traîneau Des boules d’un beau pain moelleux. « Attends, mangeons d’abord un peu. Il n’est pas bon d’être affamé. » Il mangea un petit pain rond, En mangea trois, en mangea quatre. Les mangea tous jusqu’au dernier, Sans en laisser la moitié d’un. Son œil s’assombrit, s’aveugla, Son âme emportée par la mort. Le poison mortel le tua, Et il ne put emporter l’or. Telle fut la fin des deux frères. L’homme âgé n’était pas dément : Là-bas, ainsi qu’il l’avait dit, Un grand serpent gisait vraiment.